Le document que nous publions ci-dessous fait partie des plus compromettants qui existent au sujet de la pédagogie Steiner-Waldorf et de l’Anthroposophie. Il s’agit d’un extrait des « conseils » que Rudolf Steiner a donné aux professeurs de la première école Waldorf de Stuttgart, lors de sa fondation. Nous avons commenté et publié dans un autre article de larges extraits de ces « conseils » et révélé leur caractère hautement problématique. Comme ce conseil fait partie du deuxième tome de cet ouvrage, que la Fédération des Écoles Steiner-Waldorf n’a jamais eu le courage de publier (et pour cause !), il n’était pas parvenu entre nos mains jusqu’à aujourd’hui. On y voit avec quelle haine féroce Rudolf Steiner avait en considération le peuple français, sa langue et sa culture. On y voit également quel chauvinisme bête et étroit régnait non seulement dans ses propos, sous couvert de considérations spirituelles, mais aussi dans son entourage, constamment soucieux d’abonder dans son sens et de plaire au gourou qu’il était. Une étroitesse d’esprit qui n’est pas sans rappeler celle dont les Nazis seront capables quelques temps après, ne serait-ce qu’à en juger par cette phrase répugnante :
« L’effroyable brutalité culturelle que fut la transplantation des Noirs vers l’Europe, c’est un fait terrible que le Français fit subir aux autres. Cela agit, en retour, de la manière la plus néfaste sur la France elle-même. Sur le sang, sur la race, cela agit en retour de manière incroyablement forte. Cela nourrit de manière fondamentale la décadence française. Cela fait reculer le peuple français en tant que race. » (Rudolf Steiner)
Ce texte n’est malheureusement pas un document du passé chez les anthroposophes : en le lisant, je n’ai fait que retrouver la source exacte de propos que j’avais sans cesse entendu sur ce sujet pendant des années lorsque j’étais moi-même anthroposophe, parfois mots pour mots. Car il s’agit d’idées que les anthroposophes évitent de faire circuler par écrit, mais qui se transmettent de manière orale. Cette haine de la culture française était en effet celle de certains de mes professeurs lorsque j’étais élève à l’école Steiner-Waldorf de Verrières-le-Buisson, qui reprenaient des considérations de ce genre et affirmaient eux-aussi que la langue française était le cadavre d’un peuple mourant, faite pour la diplomatie, dénaturant les âmes et les vidant de leur substance. Ces affirmations détestables étaient aussi présentes dans les bouches de certains de mes collègues très investis dans l’Anthroposophie lorsque j’étais enseignant à l’école Perceval de Chatou, ou dans les cercles de la Société Anthroposophique, en particulier la Section des Belles Lettres. Car contrairement à ce qu’affirme la Fédération des Écoles Steiner-Waldorf lorsqu’elle s’exprime publiquement sur ce sujet, comme elle le fit par exemple lors du procès du 5 avril 2013, les pédagogues anthroposophes n’ont la plupart du temps pris strictement aucun recul par rapport à de tels propos du Maître, qu’ils répètent tels quels depuis des décennies ! Les lire aujourd’hui, à présent que je ne suis plus anthroposophe, me procure un profond sentiment de honte et dégoût. De honte, car je me souviens avoir pu adhérer sans réserve à de telles affirmations, qu’on m’avait transmises alors que j’étais encore élève, à l’âge de 17 ans. De dégoût, car je me rend compte de l’erreur qui a consisté pour moi à accorder si longtemps ma confiance à une pensée que j’ai cru profonde et honnête, que j’ai étudié en y appliquant toute mon intelligence et toute mon attention, alors qu’il s’agissait de la pure expression d’un nationalisme pan-germanique se fardant de spiritualité. Mais aussi et surtout une consternation par rapport à la moralité de la personne de Rudolf Steiner, qui apparaît ici dans sa véritable nature : celle d’un individu réactionnaire et intolérant.
Il est important que les parents qui songent à inscrire leurs enfants dans une école Steiner-Waldorf soient au courant de telles choses. Car ce document n’est pas un simple témoignage concernant la doctrine anthroposophique : il s’agit de considérations s’inscrivant dans le cadre de conseils pédagogiques qui sont le fondement de la pédagogie Steiner-Waldorf ! Dans la bouche de Rudolf Steiner et dans les oreilles des pédagogues Steiner-Waldorf, ce ne sont pas de simples opinions, mais des révélations religieuses, des articles de foi. C’est pourquoi je pense que les parents devraient être en droit de savoir dans quel état d’esprit peut être enseignée la langue française dans de telles écoles. Ou sur la base de quels préjugers peuvent être accueillis de enfants d’origine africaine, ou métissés, que Steiner considère comme « un élément de corruption de la race européenne » ! Que des dérapages importants aient pu se produire sur de tels enfants dans certaines écoles Steiner-Waldorf en France, ou dans d’autres pays, comme des témoignages que j’ai recueilli me porte à le croire, apparaît dans une lumière plus forte que jamais à la lecture de ce texte :
« La pensée de Rudolf Steiner au sujet de la France, sa langue, sa culture, son âme.
Conférence faite devant le Collège des Professeurs de l’École Waldorf, le mercredi 14 février
1923, à 18 heures. Extrait du GA 300b, volume II : Konferenz mit den Lehren der Freien Waldorfschule 1919-1924. (Entretiens avec les enseignants de la Libre École Waldorf).
Ce texte est repris au catalogue allemand de l’oeuvre complète et n’est donc pas considéré comme sujet à controverse par l’éditeur.
Présentation de Nicole Dupré
Le Docteur Karutz, personnalité intéressée à la vie de l’école, a adressé une lettre au Collège des professeurs pour demander l’examen de la suppression de l’enseignement du français dans les écoles allemandes. Rudolf Steiner fait d’abord lire la lettre, en présence du Docteur Karutz, qu’il a invité, puis demande que la question soit examinée.
Dans le texte allemand du compte rendu de cette conférence, Marie de Sivers, épouse Steiner, est désignée par « Frau Dr. Steiner » que nous traduisons par Mme Dr. Steiner. X. désigne un professeur (ou plusieurs sous le même anonymat ?) de l’École Waldorf. Enfin, nous tenons à préciser dans quelles circonstances ce texte non public, réservés aux futurs professeurs allemands des Écoles Steiner, est venu en notre possession. En 1982, un ex-enseignant allemand des Écoles Steiner, installé en France, avait au cours d’une amicale réunion de travail anthroposophique, signalé aux participants du groupe que le peuple français était un peuple qui se mourait, sa langue et sa culture étant pauvres et sans avenir. La présence des anthroposophes allemands, sur le sol de France, avait, selon lui, pour objectif d’aider ce peuple moribond à accéder à l’Anthroposophie. Les participants à la réunion avaient sereinement essayé de relativiser ces affirmations péremptoires. Professeur de lettres françaises, admiratrice de la langue allemande, je ne voyais pas la nécessité de disqualifier une culture pour valoriser l’autre, ce que je dis à ce « Herr Professor » qui, très délicatement, m’envoya, par le premier courrier, ce qu’il considérait comme une argumentation définitive : la conférence de Rudolf Steiner du 14 février 1923, sur la langue et la culture française, et quelques autres textes de la même veine. Je lus ce discours avec stupéfaction et le plaçai dans mes archives. C’est dans le souci d’une recherche de la vérité que je communique aux anthroposophes ce document envoyé par le Destin.
* * *
Dr. Steiner : (…) « Ce que la France fait aujourd’hui est comme le sursaut, la dernière fureur – seulement dans l’histoire les dernières choses durent longtemps – la dernière fureur du couchant d’un peuple disparaissant du développement du monde. Ces considérations surgissent naturellement de la contemplation spirituelle de l’histoire décadente, de la romanité déclinante des peuples d’Europe. Naturellement, il y a dans l’élément espagnol et italien quelque chose de plus vital que dans le français. Le français est, parmi les peuples latins d’Europe, celui qui porte le moins de vie. La langue française est, parmi toutes les langues qui peuvent être apprises en Europe, celle qui, si je peux m’exprimer ainsi, pousse l’âme des hommes à la surface, à la surface la plus extrême de l’être humain. Elle serait celle qui peut conduire l’homme à mentir de la manière la plus honorable à la plus frivole. Elle se prête d’autant plus à cela qu’on peut y mentir de manière spontanée et loyale, parce qu’elle n’a plus aucun lien juste avec l’intériorité des hommes. Elle est parlée tout à fait à la surface de l’homme. Ainsi de la langue française, et donc de l’être français, découle l’attitude psychique telle que l’âme est commandée par la langue française. Alors qu’en allemand, l’âme, dans la puissance de l’élément volontaire, a la configuration interne de la langue, et la forme plastique de l’être de la langue, la langue française rencontre un engourdissement, et c’est elle qui commande. C’est une langue tyrannisant l’âme et par là elle crée ce qui la conduit au vide, de sorte que la culture française tout entière est, sous l’influence de sa langue, une culture qui vide l’âme. Celui qui a une sensibilité pour de telles choses peut toujours ressentir qu’aucune âme, réellement, ne parle à partir de l’Être français ; seule, une culture formelle et figée en émane. La différence est, à proprement parler, que l’on est conduit, en français, à se laisser commander par la langue. Cette liberté infinie que l’on a en allemand – et que l’on devrait revendiquer plus que cela n’est fait – de pouvoir placer le sujet à un endroit quelconque, en fonction de sa vie intérieure, cela, on ne l’a pas en français.
Les raisons pour lesquelles le français est introduit dans l’éducation des enfants, ne résident pas dans un élément pédagogique. Aucun fondement pédagogique ne justifiait l’introduction du français dans les écoles. Les circonstances firent que des raisons utilitaires ont été maquillées, masquées, quand on remplaça le vieux lycée, par l’école professionnelle, à travers toutes sortes d’établissements modernes destinés à une certaine partie de la jeunesse.
Voici de quoi il s’agit : on crut trouver dans l’enseignement du français ce que le lycée avait dans l’enseignement du latin. On a créé l’enseignement du français afin qu’il ait une vertu pédagogique semblable à celle du latin. Mais cela n’est pas conforme à la vérité. Le latin a, en soi, dans tous les cas, une logique interne. Avec le latin, une logique instinctive est apportée aux hommes. Tel n’est pas le cas avec le français. Par le français, le langage déborde en pure phraséologie dénuée de tout fondement logique, de la phraséologie uniquement – les choses doivent être radicalement dites – de sorte que beaucoup de choses, certainement, seront aliénées dans l’âme des enfants par l’enseignement du français, et l’on souhaiterait déjà que l’enseignement du français disparaisse vraiment peu à peu des fondements intérieurs de l’être.
Cela va tout à fait de soi que, dans l’avenir, il disparaître vraiment de l’enseignement.
Maintenant, si l’École Waldorf doit effectuer un nouveau départ de manière radicale, il faut présenter, alors, quelque chose d’autre.
Ce renouvellement peut résider dans la compréhension que la communauté des professeurs apporte au caractère du français, afin qu’on ait conscience d’introduire, à vrai dire, un phénomène de décadence dans l’École. Cela ne doit pas être dit aux enfants, mais on se doit déjà d’être au clair sur la question. C’est clair, mais d’un autre côté il est absolument exclu que nous entamions, à partir des Écoles Waldorf, un combat pour l’élimination de la langue française. Pour des raisons externes, cela n’est pas possible.
(…) Nous ne devons pas enlever à nos enfants la possibilité de passer dans d’autres établissements d’enseignement, après avoir satisfait aux épreuves de l’examen. (…)
Nous devons mordre dans la pomme aigre du français jusqu’à ce que quelque chose d’autre intervienne.
La situation culturelle de l’État allemand ne serait pas très différente selon que nos Écoles Waldorf enseigneraient ou non le français. Par contre un acte culturel serait accompli si, par exemple, la fausse valorisation dont jouit le français dans les pays de l’Europe du Centre, si cette fausse valorisation était vaincue par une connaissance véritable de ce que je me suis permis d’exposer, ainsi que l’a fait le Dr. Karutz.
Si l’on saisissait cela et qu’on le fasse passer dans la chair et dans le sang, et si ensuite le français disparaissait pour assainir les Écoles, alors il y aurait là un chemin qui serait un fait culturel. Il faudra commencer de manière juste à éliminer le français des Écoles en créant un mouvement spirituel sur la base d’une juste évaluation du français. (…) Le français a acquis son rang et son estime dans l’enseignement des pays étrangers à la France, non par sa portée commerciale, mais par son usage comme langue de la diplomatie. On pourrait faire d’une pierre deux coups, si l’on en venait à bout par la force du combat et le nécessaire assaut : on atteindrait à la fois la diplomatie et le français dans leur décadence. On montrerait que la diplomatie est également décadente parce que dans la diplomatie, on doit mentir. (…)
La diplomatie consiste en fait dans l’usage, à un autre niveau, des mêmes moyens qu’utilise la guerre dans la duperie de l’adversaire. Ce fut une grande erreur de Nietzsche quand il qualifia la langue allemande de langue de la tromperie. La langue française est cela ; non pas langue de tromperie, mais langue de l’étourdissement, ce qui, à vrai dire, conduit les hommes à sortir d’eux-mêmes. Il arrive à quelqu’un qui parle français avec enthousiasme, de ne pas être tout à fait en lui-même. Pas tout à fait en soi, celui qui parle le français avec enthousiasme ! Voilà qui est dit radicalement.
On doit envisager les choses ainsi ; en suite on en vient au sentiment nécessaire conduisant à remplacer le français dans l’enseignement. Les parents des enfants de l’École Waldorf peuvent être tout à fait certains que nous ne contribuerons en rien à la fausse valorisation du français, mais nous vivons sous la contrainte de l’État et, en qualité d’École Waldorf, nous ne pouvons, en fait, rien entreprendre, dans notre propre Plan scolaire, contre la langue française.
Il serait important de mettre en évidence les différentes valeurs des langues. On valoriserait ainsi, sous certains angles, la juste confiance et la force acquise pour la mission que possède la langue allemande, encore et toujours, dans la civilisation occidentale. Mais, en outre, on doit avoir une sensibilité pour percevoir la décadence ou l’élévation d’une langue.
Dans la langue allemande se trouvent de nombreux éléments porteurs de croissance, bien que, en vérité, depuis que le haut-allemand est arrivé, beaucoup d’éléments de la langue allemande soient devenus incapables d’évolution. Nous avons encore la force intérieure de transformer des mots. Nous pourrions, le cas échéant, encore employer en verbes des mots qui sont engourdis en substantifs. J’ai utilisé le mot « kraften » (forcer), comme forme verbale de force, nous pourrions faire de même avec d’autres noms. C’est compréhensible. Il y a là encore beaucoup de force intérieure. Il n’y en a plus en français, là tout est écrit. (1) Si, de cette manière, la langue commande, alors il y a quelque chose de corrompant pour l’âme humaine. Voici ce que j’ai à dire, Monsieur le Docteur. Vous le voyez, nous ne nous opposons pas à votre projet par un manque de compréhension, nous avons seulement les mains liées. En ce moment, nous ne pouvons pas examiner et discuter le sujet.
X.. : Le français a été aboli en Bavière dans les écoles publiques.
Dr. Steiner : Nous devons attendre jusqu’à ce que le Württemberg fasse quelque chose. D’un jour à l’autre, les choses peuvent changer rapidement, après quoi, on décidera et alors, on enregistrera cette résolution. Mais, si, maintenant, le français était aboli, je ne suis pas sûr qu’après quelque temps il ne soit pas de nouveau réintroduit si quelque chose de plus profond ne saisissait pas les âmes humaines.
X.. : Le décret bavarois s’applique depuis des années.
Dr. Steiner : Il s’applique actuellement, si cela se fait ici, nous ne verserons pas de larmes sur la langue française. Peut-être les professeurs de français se manifesteront-ils ?
X .. : Ainsi, tout à fait de suite, nous ne pourrions pas le faire ?
Dr. Steiner : Nous en finirons avec cette question quand elle sera devenue actuelle.
X .. : J’ai pensé qu’on saisit plutôt la spiritualité d’une langue quand elle est à l’agonie.
Dr. Steiner : C’est le cas pour les êtres humains, mais pas pour le langage, la langue française est déjà plus morte en tant que langue que ne l’était la langue latine au Moyen-Âge, au moment où elle était déjà une langue morte. Intérieurement vivait dans la langue latine, au moment où elle était langue d’église et latin de cuisine, plus d’esprit qu’il n’en vit aujourd’hui dans la langue française. Ce qui maintient la langue française debout, c’est la fureur, le sang des Français. La langue est à vrai dire morte et elle est parlée en tant que cadavre. Ceci se manifeste avec le plus de force dans la poésie française du 19ème siècle. L’âme est certainement tout à fait corrompue par l’usage de la langue française. Elle n’y gagne rien d’autre que la possibilité d’une certaine phraséologie. Cela est aussi transmis aux autres langues par ceux qui parlent le français avec enthousiasme. Il est évident qu’actuellement, le fait que les français aient maintenu debout leur langue cadavérique, a eu pour conséquence de corrompre aussi leur sang.
L’effroyable brutalité culturelle que fut la transplantation des Noirs vers l’Europe, c’est un fait terrible que le Français fit subir aux autres. Cela agit, en retour, de la manière la plus néfaste sur la France elle-même. Sur le sang, sur la race, cela agit en retour de manière incroyablement forte. Cela nourrit de manière fondamentale la décadence française. Cela fait reculer le peuple français en tant que race.
Mme Dr. Steiner : On remarque la superficialité de la langue si on la compare avec la langue italienne. On trouve, dans l’italien, toujours la possibilité de restituer la spiritualité du contenu ; en français, ce n’est jamais possible. La profondeur disparaît.
Dr. Steiner : Nous en avons fait la plus curieuse expérience. Madame Dr. Steiner a traduit deux grandes oeuvres de Schuré. Il y avait alors certaines raisons pour faire cette traduction. Et l’on avait toujours, par ces deux oeuvres, un sentiment qui, maintenant, est devenu évident.
Cela tient au fait que Schuré a conduit sa propre culture de telle sorte que sa première oeuvre fut « L’histoire du Lied ». Il a écrit en français une histoire composée du lyrisme allemand. Il pense allemand, mais il est chauvin français. Il pense dans la substance allemande, il a reçu de l’école Wagner ses premières impressions culturelles. Je me souviens encore d’une certaine véritable « furiosité » française avec laquelle Madame Schuré, qui est un peu plus âgée, a dit : quand il était étudiant, il a vendu sa montre en or pour pouvoir assister à la représentation de « Tristan ». On remarque, à vrai dire, que ces deux ouvrages se révèlent, dans le travail du traducteur, comme des retraductions d’oeuvres originellement conçues en allemand. Elles sont pensées en allemand. Les Français perçoivent cela dans Schuré. (…)
X.. : Je voudrais seulement dire comment, personnellement, cela se passe quand j’enseigne le français. Je m’élève avec enflure, je nage. Rien n’est aussi exténuant que d’enseigner le français.
Dr. Steiner : Si c’était dans le bon sens, je vous le conseillerais. Elevez-vous plutôt par d’autres moyens.
Mme Dr. Steiner : C’est absolument comique, comme cela se manifeste chez Rostand dans « Chantecler ». C’est un véritable poulailler.
Dr. Steiner : Nous devons en conclure ceci : tant que le français sera au programme, nous en dispenserons l’enseignement avec le juste sentiment, la juste appréciation de cette langue. Il nous faut abandonner la suite à l’histoire du futur.
(1) Ndt. : A partir du substantif « force » (« Kraft » en allemand), le français a créé quatre verbes : forcer – forcir – renforcer – s’efforcer. La langue allemande, à partir de « Kraft » propose seulement le verbe « kräftigen ».
Traduction : Nicole Dupré.
Publié dans Anthroposophie et Liberté n°15 de janvier 1996. »


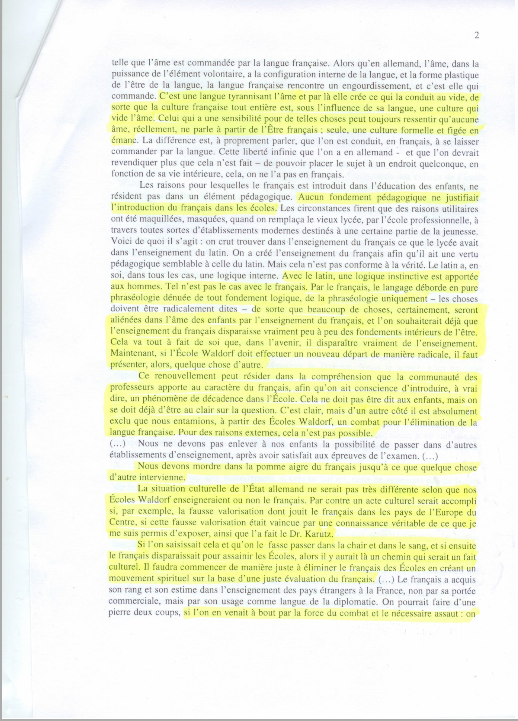


A reblogué ceci sur Blog de Grégoire Perra.
Ping : Françoise Nyssen : une anthroposophe ? | Ligue des droits de l'Homme